
Photo : Raphael Bilodeau
Présentation du village
Située dans la magnifique région touristique de Charlevoix, la municipalité des Éboulements s’étend entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes de la chaîne des Laurentides. Elle se situe au cœur du cratère de Charlevoix, un site d’impact météoritique vieux de plusieurs centaines de millions d’années. L’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix date l’impact à environ 450 millions d’années, bien que certaines études l’estiment à seulement 340 millions d’années. Quoi qu’il en soit, le Mont des Éboulements, avec son sommet culminant à plus de 760 mètres d’altitude, est considéré comme le point central de cet impact, et son cratère a profondément façonné le paysage de la municipalité et de l’ensemble de la région. La route du Fleuve (route 362) traverse le village en offrant des vues uniques et époustouflantes sur le paysage accidenté de la région. Les rangs Sainte-Marie, Saint-Antoine et Saint-Nicolas traversant les terres vers la muraille des Laurentides sont tout aussi pittoresques. Les secteurs de Cap-aux-Oies et de Saint-Joseph-de-la-Rive offrent quant à eux un accès inégalé au fleuve.
Le village des Éboulements se situe à une distance d’environ 110 km de Québec et 370 de Montréal. Entre Baie-Saint‑Paul et Saint‑Irénée, la municipalité occupe un territoire de 157,9 km2.
Le nom « Les Éboulements » tire son origine d’un important séisme, évalué à une magnitude de 7 sur l’échelle Richter, survenu le 5 février 1663 qui provoqua l’éboulement d’une petite montagne et son affaissement dans le fleuve Saint-Laurent, créant la pointe actuelle où se trouve le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.
Un microclimat composé de vents faibles et de température clémente caractérise le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive et de son plateau (secteur Éboulements‑Centre). Par contre, le secteur des Éboulements est souvent balayé par des vents violents particulièrement sur la route du Fleuve autrefois surnommée « Misère » en raison des lames de neige créées par les forts vents d’hiver.
La nature y est diversifiée en raison du dénivelé important : forêt boréale sur les hauteurs, forêt mixte vers le fleuve et marais salins près des battures. Une faune et une flore variées sont présentes, de même qu’une belle diversité d’espèces d’oiseaux.
Le premier village s’est d’abord érigé sur les rives du fleuve, dans le secteur de Saint-Joseph‑de‑la‑Rive, autrefois appelé Les Éboulements-d’en-Bas. L’économie de cette communauté étant basée sur les activités maritimes, la nécessité de développer l’agriculture provoqua l’étalement des habitations sur le haut de la côte où les terres étaient cultivables. Saint‑Joseph‑de‑la‑Rive est devenu une municipalité distincte en 1931 et a été fusionné à la municipalité des Éboulements en 2001. C’est pourquoi la municipalité des Éboulements se compose aujourd’hui de deux noyaux villageois. Ces deux magnifiques secteurs se complètent dans leur vocation agricole, forestière, maritime, touristique et de villégiature.
La population actuelle est de 1610 habitants (décret de janvier 2025) et on estime les villégiateurs à environ 500 personnes. Bien que l’agriculture occupe une place importante dans la municipalité, soit +/- 40% de son territoire, les entreprises à caractère touristique s’y sont fortement développées.
Évolution démographique
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1630 | 1610 | 1463 | 1408 |
| 2020 | 2016 | 2011 | 2006 |
| 1376 | 1331 | 1328 | 1264 |
(Sources : Recensement du Canada et décret de population du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 1er janvier 2026)
C’est en 1683 que les frères Charles et Pierre de Lessard se font concéder le territoire de La Seigneurie des Éboulements. Pierre Tremblay acquière celle-ci en 1710 et c’est lui qui développe véritablement les terres en accordant de nombreuses concessions. La municipalité des Éboulements est considérée comme le berceau de cette famille nombreuse. L’établissement des premiers colons se fait près du fleuve et sur le plateau. Il y fait construire un premier Manoir seigneurial, près du fleuve. Il ne reste aucun vestige des bâtiments de cette première Seigneurie. À compter de 1724, on y fabrique du goudron à partir du bois de pin et en 1790, le seigneur bâtit lui-même le moulin seigneurial (appelé moulin banal), avec ses fils. On peut visiter ce moulin dans un site magnifique, en haut d’une chute de 30 mètres, tout près de l’intersection de la route du Port (grande côte) et de la route du Fleuve, le long de la rivière du Seigneur. Un moulin à farine y est également construit.
Vers 1810, la Seigneurie est vendue à Pierre de Sales Laterrière. La famille Laterrière, longtemps associée à l’histoire des Éboulements, transformera et agrandira le Manoir. D’abord établi en 1855 sous le nom de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, le village des Éboulements représente l’un des plus anciens de la région de Charlevoix. En 1859, le pouvoir municipal est instauré entraînant ainsi l’abolition du régime seigneurial. À cette époque, plus de 200 habitations se dressent le long de la côte, face au fleuve. L’agglomération se développe le long de l’actuelle route du Fleuve (362), autour de l’église et de quelques commerces. L’activité économique est principalement basée sur la construction maritime, l’agriculture et la forêt.
Aujourd’hui, la partie du haut des Éboulements a conservé son caractère agricole et forestier et plusieurs fermes sont encore très actives. On y pratique des activités d’élevage de vaches laitières, de veaux, de bœufs, de porcs et d’agneaux. L’exploitation forestière est encore le plus souvent « douce » pour assurer un rendement durable. La forêt est grande autour de la montagne, les charmes de l’arrière-pays sont bien préservés.
Le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive a conservé de nombreux éléments de son passé maritime, base de son économie à la fin du 19e et au 20e siècle. Le Musée maritime de Charlevoix est établi sur les lieux mêmes du site de la construction des goélettes.
Les deux parties du village ont toujours été en interaction dans leur économie. La forêt fournissait l’approvisionnement en bois pour la construction des goélettes, les produits de la culture étaient transportés par voie maritime, le fleuve fournissait les engrais (algues, poissons) pour les terres agricoles et le bétail profitait des prairies d’herbes salées de ses rivages.
Les intempéries près du fleuve ont à deux reprises détruit et endommagé l’église. Elle fut reconstruite en 1804 dans le secteur du haut des collines (à l’endroit actuel, dans le village des Éboulements), pour être détruite à nouveau lors d’un incendie et reconstruite en 1932. Une chapelle à Saint-Joseph-de-la-Rive, à l’endroit actuel, fut construite en 1910 et réservée aux villégiateurs. C’est en 1931, lorsque Saint-Joseph-de-la-Rive obtint son statut de municipalité, que la chapelle devint accessible à tous ses citoyens. Celle-ci s’est empreinte d’un décor rappelant la vie maritime intimement liée à son histoire.
Autres témoins de l’histoire : les deux cimetières. Une visite du cimetière du village des Éboulements permet de repérer les nombreux ancêtres des Tremblay d’Amérique, des seigneurs de Sales Laterrière et de la seigneuresse de Kamouraska. Quant à celui de Saint-Joseph-de-la-Rive, Mgr Félix-Antoine Savard, écrivain et fondateur de la papeterie Saint-Gilles, y repose.
Armoiries
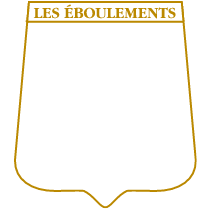
La forme de l’écu représente notre racine française.
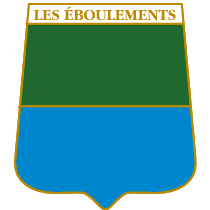
Le vert représente nos origines terriennes; le bleu nos liens avec la mer et l’or notre énergie.
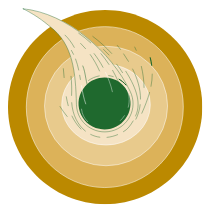
La météorite représente un événement rarissime, la présence de la montagne.

Les arbres représentent la famille, l’église et la forêt.

Les blés de mer représentent l’agriculture et la présence de la mer.

La goélette représente la richesse du patrimoine maritime.

La maison représente la richesse du patrimoine bâti.

Le « A » artistique représente la présence et le talent de nos artisans et artistes.
Drapeau


Le drapeau, tout comme les armoiries, est composé des couleurs verte, bleue et or représentant nos origines terriennes, notre lien avec la mer et notre énergie.

Au centre, nous retrouvons l’emblème floral de la municipalité, l’épervière orangée, laquelle a été choisie parce qu’elle est très présente sur notre territoire. Elle est utilisée par la Papeterie Saint-Gilles dans la fabrication du papier et est présente sur nos affiches de bienvenue.


